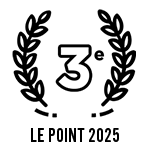Bernard Buisson, responsable de la spécialisation entrepreneuriat de l’EMLV et enseignant en stratégie, s’interroge sur la dichotomie entre la création de valeur par les entreprises à court-terme pour ses dirigeants et ses top managers et la création de valeur à long-terme pour les actionnaires de ces sociétés. La première n’ayant pas forcément une vision de la valeur globale attendue par la seconde.
Dans un article publié le 24 mars dernier dans la célèbre Harvard Business Review, Bernard Buisson détaille ainsi des études américaine et anglaise sur l’application des stratégies long-terme au sein de diverses entreprises. Extraits.
La stratégie long terme est de retour : pour combien de temps ?
Nous sommes tous familiers de l’obsession des entreprises cotées pour la création de valeur à court terme, plus communément appelée : “les résultats du prochain trimestre”.
Dans son livre “Fixing the game”, Roger Martin (à l’époque doyen de la Rotman School of Management à Toronto) a expliqué comment cette dérive a découlé de la “théorie de l’agence”, exposée en 1976 dans le Journal of Financial Economics, par les universitaires Michael Jensen et William Meckling.
Selon cette théorie, une divergence naturelle d’intérêt existe entre l’agent (dans l’entreprise, l’équipe dirigeante) et le principal (les actionnaires). Il semble donc possible de régler ce problème en alignant la rémunération de l’équipe dirigeante avec l’intérêt des actionnaires. C’est ce qu’ont mis en place les conseils d’administration, en accordant progressivement au top management des rémunérations variables de plus en plus importantes, sous forme notamment de stock options.
Dans les Etats-Unis des années Reagan, la « création de valeur pour l’actionnaire » est devenue le mantra des entreprises cotées, et Jack Welch, le P-DG de General Electric, son héros.
Effet biaisé
La solution mise en place pour régler le problème soulevé par la théorie de l’agence avait une première limite : pour des top managers, dont la durée de vie à leur poste est limitée à quelques années, la « création de valeur pour l’actionnaire » s’est naturellement transformée en « résultats du prochain trimestre ». Deuxième limite, plus embarrassante que le raccourcissement de l’horizon temporel des équipes dirigeantes, ce mouvement les a entraînées sur un terrain dangereux.
Dans “Fixing the game”, Roger Martin expose clairement comment le basculement de l’attention des entreprises en faveur de la “création de valeur pour l’actionnaire” a détourné l’attention du top management des vrais marchés vers les marchés financiers. En s’appuyant sur l’exemple du football américain, il démontre que cela reviendrait à intéresser financièrement les joueurs aux résultats des paris sportifs, plutôt qu’au jeu lui-même. Cela aurait évidemment pour conséquence que les joueurs essaieraient tôt ou tard de « truquer la partie » (« Fixing the game »), et c’est la raison pour laquelle l’accès aux paris sportifs leur est interdit.
Des chercheurs ont voulu vérifier depuis si d’éventuelles dérives se produisaient vraiment en entreprise. Ainsi, dans un article intitulé “Equity vesting and managerial myopia”, publié par le National Bureau of Economic Research en 2013, les auteurs ont démontré que les P-DG réduisent les “vrais” investissements (tels que la R&D, par exemple) quand les dates d’échéance de leurs stock options approchent.
Plus radicaux, les professeurs de la London Business School, Freek Vermeulen et Dan Cable, ont montré dans « Stop paying executives for performance » (Harvard Business Review, février 2016) que les performances variables attribuées au top management, sous toutes leurs formes (primes, stock option) ne pouvaient pas être reliées à la performance de l’entreprise, et qu’il vaudrait encore mieux pour tout le monde revenir à la plus simple des solutions : un salaire fixe.
L’obsession des entreprises pour la valeur créée pour l’actionnaire a soulevé d’autres inquiétudes, y compris chez les figures historiques de la stratégie d’entreprise. Ainsi le professeur en stratégie d’entreprise à l’Université de Harvard, Michael Porter, et Mark Kramer, le directeur général de FSG (un cabinet de conseil à but non lucratif) ont signé, en janvier 2011, un article intitulé “Creating shared value”, sous-titré “How to fix capitalism”. Si l’attention exclusive du top management est consacrée à la création de valeur immédiate pour l’actionnaire, qui va se soucier des intérêts des autres parties prenantes, la société ou l’environnement, par exemple (lire aussi la chronique « Pourquoi la plupart des entreprises n’ont-elles pas de stratégie? ») ?
Sur le terrain, rien n’a vraiment changé, et l’approche évidente pour créer de la valeur à court terme est de réduire les coûts. Les salariés des entreprises cotées se débattent donc plus que jamais avec des managers dont l’unique outil semble être une feuille Excel, et des départements Achats qui remettent aux calendes grecques la mise en place de nouvelles machines, ou changent de sous-traitants tous les ans pour de nouveaux moins chers, sans se soucier des conséquences à moyen terme, comme la perte de compétitivité, la perte de savoir-faire et l’augmentation des plaintes au sein du service après-vente. Autre variante de l’obsession pour la création de valeur à court terme, un top-management qui répond « Je ne veux pas le savoir », quand on lui fait remonter un problème potentiellement grave. On a vu où cette approche a mené Volkswagen.
Mais qui peut penser sérieusement que Steve Jobs a consacré 90 % de son temps pendant la période 2000-2007 aux réductions de coût et aux résultats trimestriels ? Pour relancer Apple, il a dû consacrer l’essentiel de son temps au développement des produits (dans l’ordre, l’iPod, l’iPad et l’iPhone) qui ont permis à l’entreprise de devenir la plus importante capitalisation boursière du monde entre 2012 et début 2016 (Google occupe depuis peu la plus haute marche du podium).
Des résultats inférieurs
Plus ironique, il semble bien que les entreprises qui privilégient l’exploitation (au détriment de l’exploration, pour reprendre les termes de l’article du professeur James March dans Organization Science de 1991) aboutissent à des résultats inférieurs en termes de création de valeur pour les actionnaires. Dans leur article « Don’t let your company get trapped by success » (Harvard Business Review, novembre 2015), Martin Reeves et Johann Harnoss, deux consultants du Boston Consulting Group, ont montré que les sociétés qui privilégient l’exploitation d’activités maîtrisées ont connu, pendant la période 2004-2014, une croissance annuelle moyenne de 4,7 %, contre 10,4 % pour les « explorateurs ». Quant au retour sur investissement pour les actionnaires, il est également supérieur pour les entreprises exploratrices (11,5 % par an, en moyenne), comparé à celui des autres entreprises (9,1 %).
[…]
Il semble que les investisseurs eux-mêmes soient fatigués des manœuvres des P-DG pour « truquer la partie ». Et ceux qui se sont exprimé récemment ne sont pas des figurants. D’après le New York Times, en 2016, Laurence Fink, le fondateur de BlackRock (le plus important gestionnaire d’actifs au monde avec 4500 milliards de dollars sous gestion), et d’autres dirigeants de poids lourds du secteur (Fidelity Investments et T. Rowe Price) se sont réunis aux côtés de l’homme d’affaires américain Warren Buffett, à l’invitation de Jamie Dimon, le patron de JPMorgan Chase. Une des conséquences de cette réunion a été l’envoi par Laurence Fink, le 1er février 2016, d’une lettre à plus de 500 P-DG du monde entier pour leur demander d’arrêter de se focaliser sur les résultats trimestriels (« La culture hystérique centrée sur les résultats trimestriels est totalement contraire à l’approche de long terme dont nous avons besoin ») et de trouver des choses plus pertinentes à faire avec leur trésorerie que de racheter des actions de leur entreprise.
Une lettre à 500 P-DG suffira-t-elle à rétablir l’équilibre entre exploration et exploitation, et à faire reculer l’obsession pour « les résultats du prochain trimestre » ? Rien n’est moins sûr. Laurence Fink avait déjà envoyé une lettre similaire l’année dernière, et il faut croire que peu de choses ont changé pour qu’il éprouve le besoin d’en envoyer une seconde. Il faut dire que la voie de l’exploration est difficile et risquée.
[…]
Dans le cas particulier de la France, l’endogamie entre la haute fonction publique et le top management des entreprises du CAC 40 ne favorise pas l’arrivée aux commandes de visionnaires. Le fait que Laurence Fink, dans sa dernière lettre, en appelle au gouvernement américain pour l’aider à changer le cours des choses, laisse penser qu’il sera difficile, aux Etats-Unis également, d’en finir avec le court-termisme.